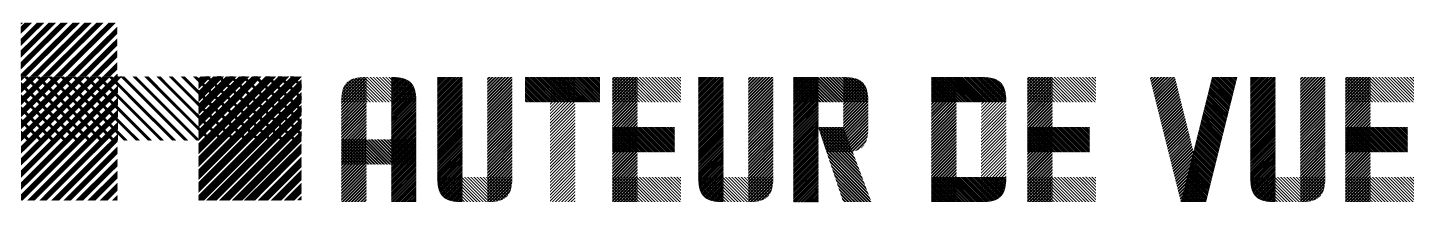
Qu’est-ce qu’une « société malade »?
publié le 08/11/2019

portrait de Stefan Zeromski, DR
Pour la première fois vient de paraître en traduction française le roman L’avant-printemps de Stefan Zeromski (1864-1925), auteur vénéré en Pologne. Ecrit en 1924, L’avant-printemps s’inscrit dans ce moment historique où la Pologne pouvait enfin être en mesure de jouir de son indépendance, acquise après 123 années de servitude mais où elle dut faire face à des conflits sociaux. Sur fond de rage dévastatrice des masses et de jalousie mortelle des individus, L’avant-printemps déploie l’histoire conjointe des vainqueurs triomphants et des vaincus étouffés par leurs frustrations, et qui se fige dans une opposition radicale.
Roman d’apprentissage, L’avant-printemps dépeint ces années de trouble profond qui caractérisent les premières décennies du XXe siècle, lorsque se révèle ce qui sera l’une des causes du malheur des temps à venir : la course éperdue pour la maîtrise du pétrole. Enjeu de cette lutte fratricide : Bakou, ville-phare des gisements pétroliers. C’est là où démarre le roman. Toute à cette soif insatiable de maîtrise du monde, la Grande guerre brise net le bonheur du jeune héros, Cezary Baryka, surnommé Czarus par des parents éperdus d’amour pour lui. Mais le père mobilisé disparaît rapidement dans les océans lointains ; la mère s’abîme dans la misère et la mort, et qu’ils soient bourreaux ou victimes, tous les voisins sombrent dans des massacres incessants. Au terme d’un voyage de déportation, Cezary finalement gagne les terres de la nouvelle Pologne et, grâce à son amitié pour Hipolit, gagnée sur les champs de bataille, achève son périple dans un lieu émergeant de nulle part et pourtant profondément historique : Nawloc.
Les romans d’apprentissage, avant d’être les romans des illusions perdues, celle des bonheurs irradiants et de leur perte irrémédiable, sont d’abord des rêveries sur l’histoire écoulée, celle des mythes et des projections apaisantes, quand les peuples croient encore aux récits des maîtres. Au cœur du drame qui se noue, se déploie la nature enchanteresse surgissant tout droit de l’imaginaire polonais, fait de manoirs profonds et de serviteurs attentionnés au service de maîtres qu’une seule tâche occupe : parcourir dans des cavalcades échevelées les champs baignées de brume et de pluie pour mieux s’unir à l’odeur des bêtes et le frôlement des arbres, et, au risque de verser dans les fondrières profondes, braver les orages qui déchirent l’horizon et bientôt lacèrent les cœurs.
Dans cette peinture où les chevaux et les hommes s’entremêlent dans un paysage de passion digne des grands peintres naturalistes polonais, trois femmes tissent le malheur d’aimer. Trois femmes marquées d’une perte irrévocable – celle de leur propre tradition, qu’elle soit nationale ou familiale – mais toutes trois brûlantes de désir pour un seul et même homme, Cezary. Trois femmes qui reflètent la pesanteur des hiérarchies sociales et des frustrations des cœurs.
Au bas de l’échelle sociale, Wanda, handicapée sinon de l’esprit du moins du cœur et qui, quoique pianiste remarquable, se consume de haine à l’encontre de celle qu’elle a surpris en train d’embrasser Cezary, lui le seul objet de son fantasme. Handicapée et bientôt, criminelle. Au milieu de l’échelle sociale, la rivale : la jeune et jolie Karolina. Héritière d’un grand domaine situé dans les confins ukrainiens mais disparu dans les désordres de la révolution russe, elle a su gagner un instant les lèvres du héros. Mais, à l’instar de sa meurtrière, Karolina bientôt se décompose pour avoir vu, elle aussi, son amoureux d’un jour la délaisser pour plus noble qu’elle : Laura. Au sommet de l’édifice donc et surplombant, inconsciente, le malheur de ses gens, Laura, la jeune veuve aussi ravissante que désargentée. Pourtant, aux seules fins de maintenir son rang dans la noblesse, Laura en vient à épouser un jeune fat, riche à millions et fier de ses cheveux pommadés, plutôt que Cezary, auquel elle s’est donnée avec passion et qui l’aime en retour d’un amour absolu ; Cezary, dont elle ne conservera que l’humiliation d’un coup de cravache vengeur infligé en réponse à son mépris d’avoir choisi son rival.
Car l’amour n’est jamais assez fort qu’il ne se retourne en un instant en son autre face, la haine qu’attise une jalousie jamais éteinte. Le court instant des bonheurs lumineux ne peut longtemps contenir la longue durée des haines recuites au feu des insatisfactions répétées. César le savait depuis longtemps. Tout au ravissement de l’entente ressentie au début de son séjour à Navloc, une pensée terrifiante l’avait tout à coup saisie que les serviteurs en dépit de leur respect pour leur maître, pourraient en réalité n’avoir qu’une seule idée fixe : se venger de leur servitude et le tuer : « Prends garde à toi frère ! » songe Cezary en regardant Hypolit leur offrir des présents précieux : « Pour une seule tabatière plaquée or, pour quelques cuillers en argent, ces mêmes crois-moi (…) ils te traîneront dans le jardin, te fracasseront le crâne à coups de hache ! Crois-moi ! Je le sais ! »
La haine des humiliés, cette frustration des pauvres, Cezary l’a éprouvée auparavant, quand en août 1920 il a croisé en sens inverse de sa marche victorieuse contre les Bolchéviques une colonne de soldats russes vaincus à laquelle s’en était pris une mégère des faubourgs de Varsovie dans une rage incontrôlée. Face à « tous ces faciès d’Astrakhans (….) Gueules de rats avec des yeux de travers », elle leur a hurlé sa rage de ressentir la faim : « On leur donnerait le bon dieu sans confession. Et tout ça, mes bonnes gens, c’est à cause de la faim ». La masse, ce sont surtout les exploités du travail, prolétaires de la terre et de l’industrie, ces Juifs misérables et offensés, toute cette foule de gueux que finalement Cesar redécouvre une fois perdu le domaine enchanteur de Navloc et l’amitié née des tranchées.
Alors revient sans cesse dans l’esprit de Cezary l’obsédante culpabilité de n’être pas à la hauteur des évènements, de ne pas agir comme les autres l’attendent, de ne pas être fidèle à sa tradition, lui le fils de bourgeois élevé dans l’innocence des gens bien nés, et qui connut un instant à Bakou les tourments d’être parmi les vaincus de l’histoire. Et dans une répétition inlassable, le regard jamais éteint de la jeune arménienne violée et assassinée par les Turcs vainqueurs, elle dont les prunelles mortes et comme vissées au regard de Cezary semblaient lui dire : « N’as-tu aucune pitié de moi soldat sans coeur ? Ne veux-tu pas me venger ? Pauvre serviteur, lâche, pitoyable ? Tu n’es qu’un homme qui craint un homme plus fort que toi ! Tu trembles comme un chien en colère ». Il faudra toute la durée du roman – de l’amour oublieux des origines jusqu’au sentiment irrémédiable d’abandon quand il aura définitivement rompu avec l’aimée – pour qu’il découvre enfin où se trouve sa place : au sein des masses des travailleurs en grève contre l’oppression.
L’avant-printemps, ce n’est déjà plus l’hiver. Mais ce n’est pas encore le temps des floraisons qui témoignent de la victoire sur le gel et les froidures. En 1924, en Pologne, la période mortifère des Partages n’est plus. Mais ce n’est pas encore, il s’en faudra de beaucoup, celle de la pleine souveraineté nationale. Peu d’années s’écouleront avant que le pays ne sombre dans les compromissions jusqu’à pactiser en 1935 avec son bourreau, l’Etat nazi pour trop tard, se reprendre. Zeromski ne vivra pas ces drames. Il meurt en 1925. Son roman pourtant résonne de ces funestes pressentiments quand il s’attache à découvrir les racines du malheur des masses : la légèreté coupable des élites, la frustration des travailleurs, et par-dessus tout le sentiment d’injustice qui engendre les révolutions, toutes aussi destructrices qu’inutiles.
Par ces réflexions, Zeromski s’inscrit de plein pied dans la pensée européenne qui ne cesse de s’interroger, hier comme aujourd’hui, sur l’irruption soudaine des masses et sur les incertitudes profondes des temps dont elles sont le signe. A ce titre, il était grand temps pour le lecteur français de découvrir cette œuvre magistrale que la traduction de Anna Cieselska-Robard a rendu avec une très grande finesse.
+ de décryptages du même auteur
Site développé par Polara Studio
